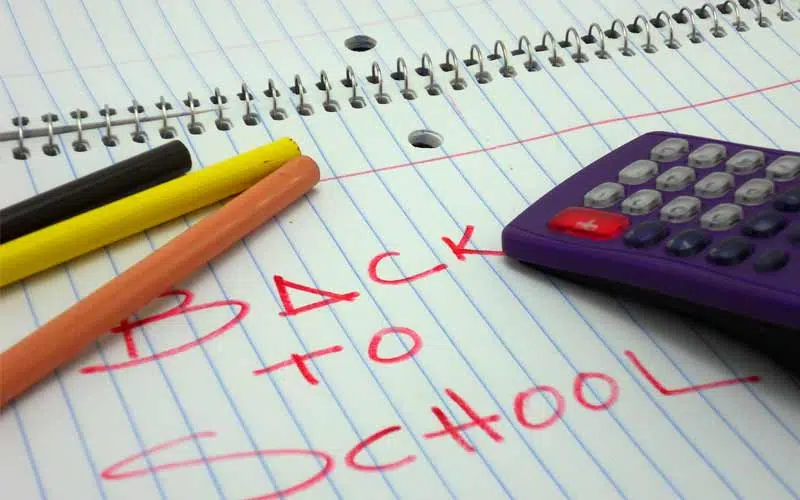Un défilé de la Fashion Week peut présenter une dizaine comme une centaine de mannequins, sans standard universel. La sélection des silhouettes répond à la fois à des enjeux de production, de casting et de message, variant selon les maisons et les saisons.
La récente multiplication de profils atypiques dans les castings bouleverse encore la donne, au point de modifier les équilibres entre visibilité, diversité et contraintes économiques. Les choix opérés sur le nombre et la variété des mannequins influencent structurellement la perception des standards corporels dans l’industrie.
Pourquoi le nombre de mannequins sur un podium n’est jamais anodin
Oubliez l’idée d’un défilé comme simple succession de mannequins : chaque présence sur le podium est calculée, pensée, orchestrée. Le nombre de modèles défile comme une partition, précis et signifiant. À Paris, Milan, New York ou Londres, la fashion week ne laisse rien au hasard : chaque silhouette a son rôle, chaque passage pèse dans la narration.
Ce chiffre, loin d’être arbitraire, dépend directement de la taille de la collection. Certaines maisons optent pour la sobriété avec une vingtaine de mannequins : chaque look s’impose alors avec plus de force. D’autres maisons, à l’inverse, frôlent la centaine pour exprimer une grandeur assumée ou une extravagance revendiquée. L’espace joue aussi son rôle : la nef monumentale du Grand Palais appelle à la démesure, tandis que les décors industriels de Milan imposent leur propre rythme, plus condensé.
Le casting, lui, ne se limite jamais à une simple question de quantité. Il s’agit d’un outil narratif puissant, capable de transformer l’énergie d’un show. Voici comment il module l’ambiance et le propos :
- Pour un défilé spectaculaire, la multiplication des mannequins crée une dynamique de groupe, presque une armée de style, qui marque les esprits.
- À l’opposé, une présentation plus confidentielle réduit l’effectif pour mieux concentrer l’attention sur chaque vêtement.
- Certains labels misent sur la diversité des profils pour toucher un public plus large et affirmer leur singularité.
Le succès d’un show se lit dans l’impact visuel qu’il laisse. Plus il y a de mannequins, plus la variété des corps, des attitudes et des allures se déploie, renforçant le message voulu. À l’inverse, un casting resserré impose une vision claire, parfois tranchée, presque manifeste. Le nombre de mannequins n’est jamais un détail : il imprime le rythme de la collection et façonne la mémoire collective d’une saison.
Quels critères dictent la sélection des mannequins aujourd’hui ?
Les règles du casting dans l’univers du mannequinat ont bougé. Il n’y a pas si longtemps, les mensurations dominantes, la taille standard et la silhouette filiforme régnaient sans partage. Aujourd’hui, ce moule se fissure. Les labels cherchent désormais des personnalités, des énergies et des histoires autant qu’un port de vêtement irréprochable.
Impossible d’ignorer le poids des réseaux sociaux dans cette évolution. Un visage comme Kendall Jenner, propulsé par Instagram, peut désormais rivaliser en influence avec une légende comme Naomi Campbell. L’audience digitale, l’engagement et la capacité à raconter une histoire personnelle deviennent des critères aussi décisifs que la démarche sur le podium. Le casting idéal s’adresse à un public mondial, connecté, toujours en quête de nouveauté.
La liste des modèles s’est enrichie de noms qui bousculent les codes. Ashley Graham, Gigi Hadid, Jourdan Dunn : chacune incarne un type de beauté différent, loin des diktats passés. On ne parle plus seulement de mensurations, mais d’attitude, de présence, de capacité à incarner une vision. Pour illustrer cette évolution, voici les critères qui guident désormais la sélection :
- Compatibilité avec les vêtements présentés et la scénographie imaginée.
- Aptitude à incarner l’image de la marque avec authenticité.
- Influence sur les réseaux sociaux, portée numérique, faculté à fédérer une communauté.
- Diversité de parcours, de morphologies et de vécus.
Derrière chaque silhouette choisie se dessine une stratégie : combiner héritage de la mode et innovation, pour que chaque mannequin soit bien plus qu’un simple porteur de vêtements, mais un acteur du récit de la collection.
L’inclusivité en question : la diversité des corps dans les défilés, mythe ou réalité ?
La question de la diversité sur les podiums ne cesse de revenir, souvent affichée, parfois contestée. Pendant longtemps, la mode n’a présenté qu’un seul type de corps, un idéal strict, quasi inatteignable. Les traits se ressemblaient, les silhouettes se répétaient. Mais depuis quelques saisons, le paysage évolue. Paloma Elsesser, Ashley Graham et d’autres figures cassent le moule et imposent des alternatives à l’esthétique unique des années Kate Moss.
À Paris, Milan, New York ou Londres, les maisons de couture tentent des incursions hors des sentiers battus. Les mannequins à la peau foncée, les profils plus âgés ou aux morphologies variées gagnent en visibilité. Pourtant, si l’on regarde de près, la majorité des mannequins d’un défilé type continue de répondre aux critères classiques de l’industrie. La différence s’affiche parfois, mais elle peine encore à s’imposer massivement.
L’objectif des marques est clair : attirer un public diversifié, capter l’air du temps. Les couvertures de magazines tels que Vogue ou Harper’s Bazaar semblent refléter cette volonté, mais la réalité des coulisses reste nuancée. Il n’est pas rare de voir une Paloma Elsesser ou une Naomi Campbell au milieu d’une majorité de mannequins au profil « traditionnel ». Le patchwork n’est jamais tout à fait complet.
Pour mesurer la diversité des corps dans la mode, il ne suffit pas d’observer la scène. Il faut compter, vérifier la répartition, suivre l’évolution d’une saison à l’autre. L’inclusivité progresse, mais pas à la vitesse d’un raz-de-marée. La vraie question reste ouverte : cette diversité est-elle une tendance passagère ou annonce-t-elle un changement durable ?
Vers une mode plus représentative : quelles évolutions à surveiller ?
Depuis le début des années 2000, la mode cherche à élargir son horizon. Les grandes maisons comme Saint Laurent, Gucci ou Balmain expérimentent de nouvelles façons de composer leurs castings. Les fashion weeks ne se contentent plus d’aligner des silhouettes conformes à un standard : chaque détail, chaque spécificité devient une force à explorer.
Paris, laboratoire de l’avant-garde, attire tous les regards. Les défilés de Givenchy, Mugler ou Paco Rabanne jonglent entre fidélité à l’héritage couture et ouverture à des talents inédits. Londres, Milan et New York suivent, chacune avec ses propres règles. Mais toutes partagent une ambition : refléter la multiplicité du public et répondre aux attentes d’une génération qui exige une mode plus ouverte, plus fidèle à la réalité.
Pour illustrer ce mouvement, voici comment certains leaders du secteur repensent leur casting :
| Maison | Évolution du casting |
|---|---|
| Gucci | Mélange de genres, profils atypiques valorisés |
| Balmain | Accent sur la pluralité ethnique et la diversité des corps |
| Givenchy | Alliage entre modèles historiques et nouveaux visages |
Les marques assument désormais une volonté de toucher un public plus vaste, d’intégrer de nouveaux récits, de transformer chaque défilé en scène de singularité. Les conférences spécialisées en business fashion l’affirment : la transformation est déjà à l’œuvre. La mode évolue, parfois sous la pression du public, parfois par conviction, mais toujours sous l’œil attentif d’un secteur en pleine mutation.
Reste à voir si la prochaine saison ira plus loin encore, jusqu’à faire du podium un vrai miroir, où chacun pourrait enfin se reconnaître.