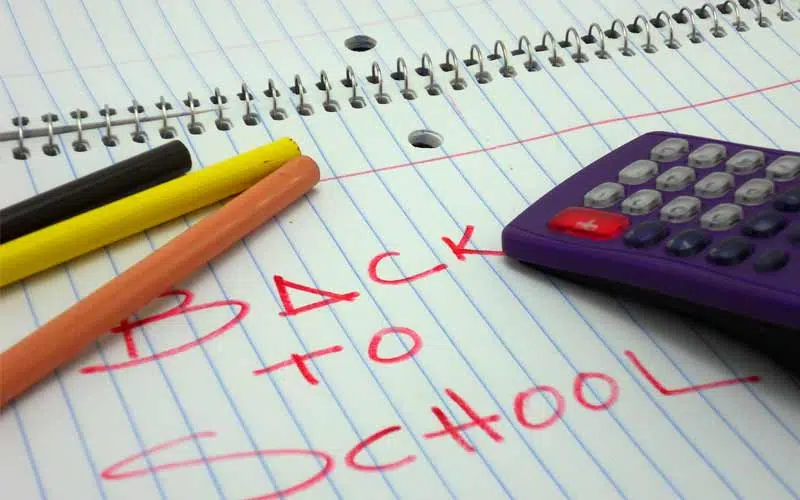Aucune chaussure ne garantit une adhérence totale sur tous les sols, même si l’étiquette promet une sécurité optimale. Certaines semelles pourtant certifiées échouent lors de tests indépendants, tandis que des modèles sans marquage spécifique affichent parfois des résultats supérieurs.
La norme EN ISO 20345 distingue plusieurs niveaux d’adhérence, mais une classification élevée ne correspond pas toujours à une performance réelle en conditions de travail. L’écart entre certification et usage quotidien suscite des interrogations sur la fiabilité des critères retenus par les fabricants.
Pourquoi l’adhérence des chaussures est un enjeu de sécurité au quotidien
La sécurité ne tient parfois qu’à une semelle. Les chaussures antidérapantes, bien plus qu’un accessoire de confort, s’imposent comme la première protection individuelle sur le terrain. Que ce soit sur un chantier, en cuisine, dans un hôpital ou une usine, chaque pas compte. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près d’un quart des accidents du travail en France surviennent à cause d’une chute de plain-pied, selon l’Assurance Maladie.
Face à ce constat, l’adhérence devient un critère déterminant pour le choix des chaussures de travail. La semelle doit jouer son rôle de rempart discret, limitant les risques de glissade sur des sols humides, gras, métalliques ou carrelés. Même avec des rampes d’accès et des panneaux de signalisation, rien ne remplace l’efficacité d’une paire de chaussures antidérapantes bien conçue.
Quelques exemples concrets montrent toute la portée de cette vigilance :
- Dans la restauration, une simple glissade sur un sol mouillé peut mettre fin à une saison entière de travail.
- À l’hôpital, le moindre faux pas met en danger soignant comme patient.
- En industrie, une chute se répercute vite sur la productivité et la santé de toute l’équipe.
Antidérapantes, chaussures et antiglisse : derrière ces mots, une exigence partagée. Plus qu’une question de confort, il s’agit d’écarter des accidents souvent évitables et de permettre à chacun de se concentrer sur ses tâches, sans avoir à surveiller chaque pas.
Quels critères techniques distinguent une chaussure réellement antidérapante ?
Choisir une chaussure antidérapante, ce n’est pas se fier au seul discours commercial. Il faut examiner la semelle de près : matériau, dessin, épaisseur. La semelle en caoutchouc reste un incontournable pour sa résistance sur sols humides ou gras. Les modèles en polyuréthane (PU) séduisent par leur légèreté et leur solidité, tout en assurant une adhérence fiable. Sur des surfaces exposées à la chaleur ou aux hydrocarbures, la semelle en nitrile apporte robustesse et sécurité.
L’observation du profil de la semelle compte tout autant : relief marqué, rainures multiples, surface non lisse. Ce travail sur le dessin favorise l’évacuation de l’eau, piège les résidus glissants, augmente la surface de contact. Les fabricants rivalisent d’ingéniosité : la sculpture de la semelle devient un véritable outil de prévention.
La protection des pieds ne dépend pas uniquement du matériau extérieur. Certains modèles misent sur des matériaux durables, parfois renforcés par une coque de protection ou des surépaisseurs. Mais la sécurité ne doit pas écraser le confort : une chaussure trop rigide, même bien notée, devient vite un handicap après quelques heures debout.
Voici les principaux points à examiner lors du choix :
- Composition des semelles (caoutchouc, PU, nitrile), à adapter selon le milieu de travail.
- Motif : relief profond, rainures et canaux pour évacuer liquides et particules.
- Matériaux : privilégier résistance, flexibilité et maintien.
- Sécurité : présence de coques, amorti, maintien latéral solide.
En définitive, la performance se juge sur la résistance au glissement et la capacité de la chaussure à suivre naturellement le mouvement du pied. Trouver le bon équilibre entre sécurité, aisance et longévité ne doit rien au hasard.
Normes et tests : comment s’assurer de la conformité et de l’efficacité antidérapante
La sécurité antidérapante n’est pas qu’un argument de vente : elle s’évalue selon des standards précis. Deux normes dominent : EN ISO 20347 pour les chaussures de travail, EN ISO 20345 pour les modèles de sécurité. Ces référentiels imposent des tests stricts sur différents types de sols.
Trois certifications principales guident le choix : SRA pour les tests sur carrelage mouillé à l’eau savonneuse, SRB pour l’acier recouvert de glycérine, SRC pour les deux situations combinées. Ce classement apparaît sur l’étiquette ou la fiche technique, souvent via les mentions S1, S2, S3 SRC.
Les laboratoires spécialisés utilisent pour cela des appareils dédiés : tribomètre SATRA TM144, Brungraber Mark II, tribomètre pendulaire… Ces outils mesurent le coefficient de frottement (SCOF ou DCOF) entre la semelle et la surface, à sec comme à l’humide.
Il existe parfois des tableaux récapitulatifs permettant de comparer les performances, encore rares dans les notices produits. Sur le terrain, le marquage SRC reste le repère le plus fiable : il atteste de la conformité face aux principaux risques. Une chaussure respectant ces normes devient un EPI à part entière, conçu pour durer et protéger.
Adapter ses chaussures antidérapantes à son environnement : conseils pratiques pour chaque usage
Le choix de la paire idéale dépend du contexte : cuisine, milieu hospitalier, entrepôt ou chantier, chaque environnement présente ses propres difficultés. La glissance n’est pas la même sur un carrelage gras, un sol métallique ou un couloir fraîchement lavé. Il faut prendre en compte la nature du sol, la fréquence des projections et le rythme de la journée.
En restauration, il vaut mieux opter pour une semelle à sculpture profonde, avec de larges rainures. La graisse et les liquides s’accumulent : une semelle en caoutchouc certifiée SRC réduit nettement le risque de chute. En industrie, la résistance aux hydrocarbures et la robustesse des matériaux (PU, nitrile) sont prioritaires pour assurer la protection et la durée de vie des chaussures. Côté médical, le confort n’est pas négociable : légèreté, absorption des chocs, facilité d’entretien. Les experts recommandent d’inspecter régulièrement la semelle, car une usure avancée rend la chaussure inefficace.
Quelques conseils pratiques
- Contrôlez le GRIP rating ou la certification SRC sur l’étiquette au moment de l’achat.
- Entretenez vos chaussures : nettoyage fréquent, séchage naturel, vérification de l’état des rainures.
- Remplacez les chaussures dès que l’adhérence faiblit, surtout en cas d’utilisation intensive.
- Pour des environnements très spécifiques, privilégiez les technologies TripGuard ou SpillGuard (citées par des marques comme Shoes For Crews ou Karl & Max).
Certains établissements misent sur le cuir recyclé pour des raisons environnementales ; néanmoins, la résistance au glissement dépendra surtout du traitement de la semelle. Les tests publiés par CTC France offrent un aperçu indépendant des performances sur le marché et permettent de comparer efficacement les modèles.
Parfois, il suffit d’un détail sur la semelle pour changer le quotidien d’une équipe entière. Quand la sécurité s’invite à chaque pas, mieux vaut marcher avec la certitude d’avoir fait le bon choix.